📚 TABLE DES MATIÈRES
- La lettre
- Analyse de la lettre
- Thèmes de la douleur, du souvenir et des objets
- Émergence de l’indépendance et de la liberté
- Critique sociale et condition féminine
- Analyse linéaire de la lettre trente‑sept
- Conclusion
La lettre
Rassurez-vous, trop généreux ami, je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent en sureté, & que moins agitée, je ne pusse calmer vos inquiétudes. Je vis ; le destin le veut, je me soumets à ses loix.
Les soins de votre aimable sœur m’ont rendu la santé, quelques retours de raison l’ont soutenue. La certitude que mon malheur est sans reméde a fait le reste. Je sçais qu’Aza est arrivé en Espagne, que son crime est consommé, ma douleur n’est pas éteinte, mais la cause n’est plus digne de mes regrets ; s’il en reste dans mon cœur, ils ne sont dus qu’aux peines que je vous ai causées, qu’à mes erreurs, qu’à l’égarement de ma raison.
Hélas ! à mesure qu’elle m’éclaire, je découvre son impuissance, que peut-elle sur une ame désolée ? L’excès de la douleur nous rend la foiblesse de notre premier âge. Ainsi que dans l’enfance, les objets seuls ont du pouvoir sur nous ; il semble que la vue soit le seul de nos sens qui ait une communication intime avec notre ame. J’en ai fait une cruelle expérience.
En sortant de la longue & accablante léthargie où me plongea le départ d’Aza, le premier desir que m’inspira la nature fut de me retirer dans la solitude que je dois à votre prévoyante bonté : ce ne fut pas sans peine que j’obtins de Céline la permission de m’y faire conduire ; j’y trouve des secours contre le désespoir que le monde & l’amitié même ne m’auroient jamais fournis. Dans la maison de votre sœur ses discours consolans ne pouvoient prévaloir sur les objets qui me retraçoient sans cesse la perfidie d’Aza.
La porte par laquelle Céline l’amena dans ma chambre le jour de votre départ & de son arrivée ; le siége sur lequel il s’assit, la place où il m’annonça mon malheur, où il me rendit mes Lettres, jusqu’à son ombre effacée d’un lambris où je l’avois vu se former, tout faisoit chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur.
Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les idées agréables que j’y reçus à la premiere vue ; je n’y retrouve que l’image de votre amitié & de celle de votre aimable sœur.
Si le souvenir d’Aza se présente à mon esprit, c’est sous le même aspect où je le voyois alors. Je crois y attendre son arrivée. Je me prête à cette illusion autant qu’elle m’est agréable ; si elle me quitte, je prends des Livres, je lis d’abord avec effort, insensiblement de nouvelles idées enveloppent l’affreuse vérité qui m’environne, & donnent à la fin quelque relache à ma tristesse.
L’avouerai-je, les douceurs de la liberté se présentent quelquefois à mon imagination, je les écoute ; environnée d’objets agréables, leur propriété a des charmes que je m’efforce de goûter : de bonne foi avec moi-même je compte peu sur ma raison. Je me prête à mes foiblesses, je ne combats celles de mon cœur, qu’en cedant à celles de mon esprit. Les maladies de l’ame ne souffrent pas les remedes violens.
Peut-être la fastueuse décence de votre nation ne permet-elle pas à mon âge, l’indépendance & la solitude où je vis ; du moins toutes les fois que Céline me vient voir, veut-elle me le persuader ; mais elle ne m’a pas encore donné d’assez fortes raisons pour me convaincre de mon tort ; la véritable décence est dans mon cœur. Ce n’est point au simulacre de la vertu que je rends hommage, c’est à la vertu même. Je la prendrai toujours pour juge & pour guide de mes actions. Je lui consacre ma vie, & mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand y regnera-t-elle sans partage & sans retour ?
Analyse de la lettre
La lettre trente‑sept figure parmi les lettres ajoutées dans l’édition définitive de 1752. Dans les premières éditions elle est parfois numérotée trente‑quatre ou trente‑huit, ce qui explique que les commentateurs hésitent sur le numéro exact. Elle correspond cependant à la dernière lettre écrite par Zilia, adressée non plus à Aza mais au chevalier Déterville. Peu après avoir appris que son fiancé l’a trahie en épousant une Espagnole, Zilia se retire dans une maison que le chevalier et sa sœur lui ont achetée. Elle choisit de vivre dans la solitude, d’étudier et de jouir de la simple satisfaction d’exister. La lettre se situe après un long parcours où Zilia est passée par l’enlèvement, l’émerveillement, la découverte des contradictions françaises et la souffrance due au silence d’Aza. Les commentateurs soulignent que ce revirement marque l’aboutissement de son évolution : elle passe du désespoir de la lettre VI, où elle désirait mourir par amour, à la joie tranquille du plaisir d’être. Zilia refuse désormais d’être définie par un homme, préférant l’amitié et la connaissance. Elle s’écarte ainsi des récits sentimentaux traditionnels et rompt avec le modèle de la soumission féminine.
Le passage le plus célèbre de cette lettre se lit dans l’édition de 1752 : « Le plaisir d’être ; ce plaisir oublié, ignoré même de tant d’aveugles humains ; cette pensée si douce, ce bonheur si pur, je suis, je vis, j’existe, pourroit seul rendre heureux, si l’on s’en souvenoit, si l’on en jouissoit, si l’on en connoissoit le prix ». Cette exclamation condensée résume la revendication d’une existence individuelle. Les commentateurs y reconnaissent un écho à la philosophie des Lumières qui cherche le bonheur dans la vie présente. On peut y lire dans cette formule la persévérance de l’être, une sorte de conatus spinozien qui anime la quête d’indépendance. Pour la critique moderne, cette lettre constitue un geste précurseur du féminisme : la protagoniste choisit l’amitié et l’étude plutôt que le mariage et revendique la souveraineté de sa propre existence.
La singularité de la lettre trente‑sept tient à l’évolution du destinataire. Jusqu’alors, Zilia écrivait surtout à Aza, entretenant l’illusion que son fiancé pouvait la lire. Ici, elle s’adresse à Déterville, l’ami qui a remplacé le fiancé. La lettre s’ouvre sur une adresse bienveillante : « Rassurez‑vous, trop généreux ami, je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent en sureté ». Le ton est confiant et apaisant ; Zilia veut soulager les inquiétudes de son ami et affirmer sa résignation devant un destin qu’elle ne maîtrise pas. Le choix du terme ami souligne l’évolution de la relation : Déterville n’est plus un prétendant, mais un confident. La majuscule initiale marque une salutation solennelle, typique de la correspondance de l’époque, tandis que le pronom je s’impose immédiatement, révélant l’intimité du monologue intérieur.
Zilia mélange narration et introspection. Elle relate des faits – le départ d’Aza, son retrait dans la maison – mais s’attarde surtout sur son état d’âme. Les phrases longues, ponctuées de points‑virgules, traduisent la complexité de sa pensée. Lorsqu’elle évoque la perte de santé et la guérison, elle attribue aux soins de la sœur de Déterville et aux retours de la raison le maintien de sa vie : « Les soins de votre aimable sœur m’ont rendu la santé, quelques retours de raison l’ont soutenue ». La raison est personnifiée, elle soutient une santé fragile, mais elle reste impuissante à effacer la douleur. Zilia se livre à une sorte d’auto‑analyse : elle constate que la certitude de l’infidélité d’Aza lui apporte une forme d’apaisement, car la cause de sa douleur n’est plus digne de ses regrets : « s’il en reste dans mon cœur, ils ne sont dus qu’aux peines que je vous ai causées, qu’à mes erreurs, qu’à l’égarement de ma raison ». Cette introspection transforme la souffrance amoureuse en remords tournés vers elle‑même.
La lettre adopte également un ton réflexif lorsqu’elle interroge les limites de la raison. Zilia avoue : « Hélas ! à mesure qu’elle m’éclaire, je découvre son impuissance, que peut‑elle sur une ame désolée ? ». La raison est perçue comme une lumière qui éclaire, mais cette lumière révèle surtout sa propre impuissance face à la douleur. L’emploi de l’interjection Hélas ! exprime la lamentation et l’auto‑compassion. Cette réflexion s’inscrit dans la sensibilité des Lumières : la raison peut guider mais ne suffit pas à panser les blessures du cœur. Zilia compare l’excès de la douleur à la faiblesse du premier âge ; comme dans l’enfance, les objets ont un pouvoir sur nous. Cette observation traduit une psychologie fine : la souffrance intense nous replonge dans la dépendance sensorielle.
Le style épistolaire permet une oscillation entre l’adresse à l’ami et le soliloque intérieur. Dans certains passages, Zilia semble se parler à elle‑même. Lorsqu’elle avoue qu’elle se retire dans la solitude, elle confie une décision intime : « le premier desir que m’inspira la nature fut de me retirer dans la solitude que je dois à votre prévoyante bonté ». Il s’agit d’une digression introspective plutôt qu’une information pour le destinataire, car l’ami connaît déjà cette retraite. La lettre devient un espace de réflexion où Zilia examine ses sentiments, ses faiblesses et ses espoirs.
Le lexique de la vue et de l’âme occupe une place centrale. Zilia affirme que les objets et le sens de la vue ont un rapport intime avec l’âme : « il semble que la vue soit le seul de nos sens qui ait une communication intime avec notre ame ». Cette formule suggère que la perception visuelle est le vecteur par lequel les souvenirs et les émotions entrent en résonance avec l’esprit. La correspondance de Zilia reflète ainsi une modernité psychologique : elle met en évidence la relation entre les sens et la mémoire, et l’importance des images dans la construction du moi.
Thèmes de la douleur, du souvenir et des objets
La lettre trente‑sept est traversée par le thème de la douleur. Zilia ne se contente pas de répéter son chagrin ; elle analyse ses mécanismes et son dépassement. Elle commence par se soumettre au destin : « Je vis ; le destin le veut, je me soumets à ses loix ». Cette résignation se teinte de fatalisme : la vie n’est plus un choix mais une contrainte imposée par un destin supérieur. Le lexique du malheur – malheur, douleur, peines, égarement – jalonne la lettre. Cependant, Zilia reconnaît que son malheur est sans remède et que la cause n’en est plus digne de ses regrets. En apprenant qu’Aza est arrivé en Espagne et a consommé son crime, elle comprend que son deuil doit se tourner ailleurs ; elle se repent davantage d’avoir causé des peines à Déterville que de la perte d’un amour devenu indigne. La douleur se transforme en culpabilité envers l’ami qui l’a soutenue.
Le souvenir est déclenché par les objets et les lieux. Zilia explique que dans la maison de la sœur de Déterville, chaque détail ravive la trahison d’Aza : « La porte par laquelle Céline l’amena dans ma chambre … le siége sur lequel il s’assit … la place où il m’annonça mon malheur … jusqu’à son ombre effacée d’un lambris où je l’avois vu se former, tout faisoit chaque jour de nouvelles plaies à mon cœur ». La multiplication des compléments circonstanciels crée un effet de liste obsédante ; chaque élément du décor est un témoignage de la trahison et provoque une souffrance renouvelée. La mémoire visuelle s’impose à la raison : même si la protagoniste sait que son malheur est sans remède, les objets conservent un pouvoir traumatique. Ce passage montre comment la maison devient un espace de mémoire douloureuse, où la souffrance est reproduite par les traces matérielles du passé.
Pour échapper à ces blessures, Zilia choisit la retraite offerte par Déterville. Dans sa propre maison, elle ne rencontre que des images agréables : « Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les idées agréables que j’y reçus à la premiere vue ; je n’y retrouve que l’image de votre amitié & de celle de votre aimable sœur ». Le contraste entre la maison de Céline et sa propre demeure est net : l’une est hantée par le souvenir d’Aza, l’autre est un refuge où les objets évoquent l’amitié et la protection. La vue devient un moyen de choisir ses souvenirs ; Zilia se prête à l’illusion d’attendre l’arrivée d’Aza dans ce lieu, pour prolonger l’agréable.
La lettre associe également le souvenir à la lecture. Lorsque l’illusion se dissipe, Zilia prend des livres : « je prends des Livres, je lis d’abord avec effort, insensiblement de nouvelles idées enveloppent l’affreuse vérité qui m’environne, & donnent à la fin quelque relâche à ma tristesse ». La lecture est un remède doux qui enveloppe la vérité et l’estompe temporairement. Ce passage évoque le pouvoir thérapeutique de la fiction ou de l’étude : en se plongeant dans d’autres idées, Zilia parvient à créer des pensées qui voilent sa douleur. Ce rôle apaisant de la lecture se retrouve plus loin dans sa réflexion sur la connaissance. En découvrant l’Europe, elle comprend que l’acquisition du savoir lui offre un nouvel univers et la liberté de penser. Ainsi, la lecture n’est pas seulement une distraction ; elle est un chemin vers l’autonomie intellectuelle.
Enfin, la lettre aborde le pouvoir des objets dans la construction de l’identité. Zilia avoue éprouver quelquefois « les douceurs de la liberté » lorsqu’elle contemple des objets agréables et la propriété qu’elle possède. Elle reconnaît que l’idée de posséder et de jouir d’un espace personnel a des charmes. Ce sentiment révèle l’importance de la matérialité dans l’élaboration du moi. L’héroïne, qui a été vendue et donnée comme un objet, découvre le plaisir d’avoir des biens et de choisir sa vie. En même temps, elle se méfie de sa raison et de ses faiblesses : elle se prête à ses faiblesses et ne combat celles de son cœur qu’en cédant à celles de son esprit. Cette confession subtile exprime la difficulté de concilier la recherche de liberté avec les normes sociales et les contraintes intérieures.
Émergence de l’indépendance et de la liberté
La lettre trente‑sept marque un tournant vers l’émancipation de Zilia. Après avoir appris la trahison d’Aza, l’héroïne considère que sa douleur n’est plus justifiée et qu’elle doit reconvertir ses sentiments. Ce renversement se traduit par une réflexion sur la liberté. Elle confesse : « L’avouerai‑je, les douceurs de la liberté se présentent quelquefois à mon imagination, je les écoute ; environnée d’objets agréables, leur propriété a des charmes que je m’efforce de goûter ». La formule « L’avouerai‑je » introduit un aveu intime, presque coupable, car la liberté est un concept nouveau pour elle. Jusqu’alors, Zilia avait vécu sous la loi des prêtres, des conquistadors puis sous la protection de Déterville. Désormais, elle envisage la possibilité de disposer de son temps, de sa maison et de sa vie. Les douceurs de la liberté évoquent un plaisir calme et sensuel ; la propriété des objets renforce ce sentiment de maîtrise.
Toutefois, Zilia nuance cette aspiration : « de bonne foi avec moi‑même je compte peu sur ma raison. Je me prête à mes foiblesses, je ne combats celles de mon cœur, qu’en cédant à celles de mon esprit ». La raison, qu’elle a glorifiée plus tôt, est ici reléguée au second plan. Elle admet qu’elle manque de force pour résister aux tentations de son cœur, mais qu’elle peut détourner ces faiblesses en se consacrant à l’étude. Cette lucidité traduit une conception plus pragmatique de la liberté : l’indépendance ne se conquiert pas par des remèdes violents mais par un ajustement subtil entre les désirs et l’intellect. La phrase « Les maladies de l’ame ne souffrent pas les remedes violens » résume cette philosophie. Elle souligne qu’il faut une guérison douce, lente et intérieure pour surmonter les blessures du passé.
Zilia mesure également la distance entre sa conception de la décence et celle des Français. Elle observe que la fastueuse décence de la nation française ne permet peut‑être pas à son âge l’indépendance et la solitude où elle vit. La décence française est associée à l’apparence et à la conformité sociale, tandis que pour Zilia la véritable décence est dans son cœur : « Ce n’est point au simulacre de la vertu que je rends hommage, c’est à la vertu même ». Elle revendique un jugement moral intérieur qui n’a pas besoin d’être validé par les codes sociaux. Cette affirmation la libère du regard d’autrui ; elle décide de prendre la vertu pour juge et guide de ses actions. Dans cette perspective, la liberté n’est pas la licence mais la fidélité à une éthique personnelle. L’héroïne consacre sa vie à la vertu et son cœur à l’amitié, en se demandant quand elle régnera sans partage & sans retour. Cette attente d’une amitié pure signale l’aspiration à une relation égalitaire qui échappe à l’emprise passionnelle.
Cette quête de liberté trouve son aboutissement dans l’ultime exclamation de la lettre 38 : « Le plaisir d’être ; ce plaisir oublié, ignoré même de tant d’aveugles humains ; cette pensée si douce, ce bonheur si pur, je suis, je vis, j’existe ». Cette phrase condense la découverte de l’existence pour elle‑même. Les commentateurs y voient une idée centrale : la conscience du simple fait d’exister peut être une source de bonheur. À la fin Zilia refuse de se soumettre à l’amour ou au mariage et choisit la solitude et l’étude comme moyen d’émancipation. Ce parcours symbolise l’affirmation du sujet féminin : Zilia passe de l’état de femme aimante dépendante à celui de femme qui se suffit à elle‑même.
La lettre trente‑sept annonce cette conclusion en décrivant l’éveil de la liberté. En goûtant la solitude, en prenant plaisir aux objets de sa propriété et en s’initiant à la lecture, Zilia se prépare à dire plus tard qu’il suffit de vivre. Elle transforme la passion amoureuse en amitié et la douleur en curiosité intellectuelle. Cette évolution illustre l’esprit des Lumières qui valorise l’individu et la connaissance. La recherche du plaisir d’être n’est pas un égoïsme isolé mais la volonté de faire fructifier ses capacités pour mieux s’ouvrir aux autres. En invitant Déterville à partager des plaisirs innocents et durables et à transformer l’amitié en espace de croissance mutuelle, Zilia propose un modèle relationnel fondé sur l’égalité et l’échange.
Critique sociale et condition féminine
Le roman de Graffigny constitue aussi une satire des mœurs françaises et une réflexion sur la condition féminine. La lettre trente‑sept, bien qu’intimiste, s’inscrit dans cette dimension critique. Zilia oppose son propre sens de la vertu au simulacre de vertu dont elle accuse la société parisienne. La fastueuse décence évoque les usages superficiels d’une noblesse qui se conforme aux apparences. En tant qu’étrangère et femme, Zilia subit une double marginalisation : elle est considérée comme un objet exotique, et son sort est décidé par des hommes. Elle rappelle que la véritable décence réside dans la fidélité à ses principes et non dans l’adhésion à des règles sociales qui perpétuent l’injustice.
Le regard de Zilia sur la société française est façonné par son statut de captive. Dès les premières lettres, elle observe la frivolité et l’affectation des Français : « cette nation n’est point ce qu’elle paraît ; l’affectation me paraît son caractère dominant ». Elle critique la galanterie qui masque des intérêts égoïstes, l’hypocrisie du clergé et l’inégalité entre les sexes. Dans les lettres ajoutées en 1752, elle dénonce explicitement le statut des femmes françaises, maintenues volontairement dans l’ignorance et la frivolité. La lettre trente‑sept prolonge cette critique en prônant une vertu intérieure qui s’oppose aux faux semblants. En refusant de céder à la passion de Déterville, Zilia réaffirme son autonomie morale : elle ne veut pas être l’objet d’un don ni la récompense d’une générosité intéressée.
L’œuvre s’inscrit dans le mouvement des Lumières qui interroge les hiérarchies sociales et le rôle des femmes. Graffigny crée une héroïne définie autant par son intellect que par ses émotions et que la fin donne à Zilia une indépendance sans précédent, remettant en question les présupposés traditionnels sur le rôle des femmes. En faisant de Zilia une observatrice critique de la société française, l’autrice propose un décentrement qui permet d’identifier les injustices. La trahison d’Aza et les pressions de Déterville symbolisent la domination masculine : l’un trahit son engagement, l’autre offre sa protection en espérant un mariage. Zilia, en choisissant la solitude, refuse de devenir l’objet d’un échange et rompt avec les modèles narratifs où l’héroïne se réalise par l’amour. Elle s’affirme comme sujet pensant, capable de juger, de choisir et de construire son propre destin.
La condition féminine est également interrogée à travers la question de la voix. Dans un roman épistolaire, écrire est un acte d’affirmation. Zilia écrit sans recevoir de réponse ; ses lettres se transforment en journal intime, puis en correspondance avec Déterville. En s’adressant à un ami et non à un amant, elle se libère de la posture de femme qui attend et supplie. Son écriture devient un espace de pensée et de résistance. Les commentateurs remarquent que l’ultime exclamation « je suis, je vis, j’existe » est une proclamation d’identité : Zilia, qui n’a cessé d’être définie par son appartenance (prêtresse, fiancée, captive) affirme enfin son existence indépendante. Ce cri rejoint les revendications modernes de reconnaissance de l’existence des femmes en dehors des rôles conjugaux ou maternels.
Analyse linéaire de la lettre trente‑sept
Pour saisir la progression interne de cette lettre, il est utile d’en proposer une analyse linéaire qui met en relief les différentes étapes du discours de Zilia et la manière dont l’autrice utilise la forme épistolaire pour exprimer une transformation profonde.
Dans l’incipit, Zilia rassure son ami et se soumet au destin. Le début, « Rassurez‑vous, trop généreux ami, je n’ai pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent en sureté », combine l’adresse directe au destinataire et l’annonce d’une intention : elle écrit pour calmer les inquiétudes de son ami. La présence de la majuscule initiale Rassurez‑vous souligne l’entrée en matière. Elle enchaîne avec la reconnaissance du destin : « Je vis ; le destin le veut », qui montre une acceptation fataliste. La phrase se termine sur la soumission aux lois du destin, marquant une résignation.
Dans un second mouvement, Zilia évoque les soins reçus et l’apaisement de sa douleur. Elle reconnaît la bonté de la sœur de Déterville : « Les soins de votre aimable sœur m’ont rendu la santé ». La santé physique est associée à des retours de raison, comme si la convalescence passait par la rationalité. La certitude que son malheur est sans remède agit comme un calmant : en apprenant que Aza est arrivé en Espagne et a consommé son crime, elle cesse de s’aveugler. Les regrets qui demeurent ne portent plus sur Aza mais sur ses propres erreurs et sur la peine infligée à son ami. Cette redirection du regret est essentielle : la douleur amoureuse se transforme en culpabilité morale, ce qui amorce la rupture avec l’amour passionné.
Zilia aborde ensuite l’impuissance de la raison face à la souffrance. Elle s’exclame : « Hélas ! à mesure qu’elle m’éclaire, je découvre son impuissance ». La raison est comparée à une lumière qui révèle la faiblesse humaine. L’excès de la douleur renvoie la protagoniste à la faiblesse du premier âge ; elle remarque que, comme dans l’enfance, les objets seuls ont du pouvoir sur nous. Cette comparaison installe une réflexion sur la perception : la vue, parmi les sens, entretient une communication intime avec l’âme. Zilia affirme avoir fait une expérience cruelle de cette vérité, annonçant le passage suivant qui décrit les lieux traumatisants.
Le quatrième mouvement est consacré au rôle traumatique des objets. Zilia raconte la léthargie qui a suivi le départ d’Aza et son désir de se retirer dans la solitude offerte par Déterville. Elle explique comment les objets de la maison de Céline ravivaient sans cesse la perfidie d’Aza : la porte par laquelle il est entré, le siège où il s’est assis, la place où il a annoncé son malheur, et même son ombre effacée sur un lambris. La répétition des descriptions marque l’obsession et la blessure ouverte. Chaque détail est une nouvelle plaie au cœur, une métaphore qui matérialise la douleur.
Le cinquième mouvement contraste avec le précédent en présentant la maison de Zilia comme un lieu de réconfort. « Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les idées agréables ». Zilia y retrouve l’image de l’amitié et de la protection. Elle s’y abandonne à l’illusion d’attendre Aza, mais cette illusion est volontaire et douce. Lorsque cette illusion se dissipe, elle recourt à la lecture pour envelopper l’affreuse vérité. La lecture est décrite comme un processus : d’abord un effort, puis l’émergence de nouvelles idées, enfin un relâchement de la tristesse. Ce mouvement montre comment la protagoniste développe des stratégies pour gérer son chagrin.
Dans le sixième mouvement, Zilia admet qu’elle goûte parfois les plaisirs de la liberté. « L’avouerai‑je, les douceurs de la liberté se présentent quelquefois à mon imagination ». Cette confession marque une évolution par rapport à son attachement exclusif à Aza. Elle écoute ces idées de liberté, se laisse séduire par la propriété et reconnaît sa faible confiance en sa raison. Elle se prête à ses faiblesses, cède à celles de son esprit pour combattre celles de son cœur. Ce passage met en scène une lutte intérieure entre le désir de liberté et la fidélité à l’image de l’amante fidèle.
Le septième mouvement aborde la question de la décence et des normes sociales. Zilia s’interroge : « Peut‑être la fastueuse décence de votre nation ne permet‑elle pas à mon âge, l’indépendance & la solitude où je vis ; du moins toutes les fois que Céline me vient voir, veut‑elle me le persuader ». Elle entend la voix de Céline qui veut l’arracher à sa solitude, mais elle résiste. Elle affirme que la véritable décence est dans son cœur et qu’elle rend hommage à la vertu et non à son simulacre. Elle annonce qu’elle prendra toujours la vertu pour juge et guide de ses actions et qu’elle consacre sa vie à la vertu et son cœur à l’amitié. La conclusion est une interrogation : « Hélas ! quand y regnera‑t‑elle sans partage & sans retour ? ». Cette question laisse en suspens la possibilité d’une amitié idéale exempte de passion et de retour.
Cette progression montre comment la lettre passe de l’apaisement des inquiétudes de Déterville à l’affirmation d’une nouvelle identité. Chaque mouvement est marqué par une transition émotive : de la résignation au remords, de la réflexion à la description, de l’illusion à l’aveu, de la confession à la revendication morale. Zilia utilise la lettre comme un espace où se déroulent ses pensées et où se construit sa liberté.
Conclusion
La lettre trente‑sept des Lettres d’une Péruvienne illustre la richesse psychologique et la modernité du roman de Françoise de Graffigny. À travers la voix d’une femme étrangère aux prises avec le chagrin, l’autrice explore des thèmes universels : la douleur, le souvenir, la puissance des objets, l’illusion et l’émergence de la liberté. Zilia se soumet d’abord au destin, remercie l’amie qui l’a sauvée, puis analyse son propre égarement. La découverte de l’impuissance de la raison face à la souffrance et l’importance de la vue dans la relation entre le corps et l’âme révèlent une compréhension fine des ressorts intimes. Les objets chargés de mémoire deviennent des plaies ouvertes, tandis que la lecture et la solitude offrent des refuges.
La lettre annonce également l’indépendance de Zilia, qui se manifeste pleinement dans l’exclamation finale « je suis, je vis, j’existe » de la lettre suivante. En goûtant les douceurs de la liberté et en affirmant que la véritable décence réside dans l’intimité de son cœur, Zilia prépare un acte de rupture : elle refuse le mariage et choisit l’amitié et l’étude. Cette évolution place l’œuvre de Graffigny au cœur des débats des Lumières sur la condition féminine et la critique sociale. En offrant une héroïne qui se défait de la tutelle masculine et revendique sa subjectivité, l’autrice propose un modèle d’émancipation qui continue à résonner avec le public moderne. Le roman, succès de son temps et redécouvert par la critique féministe, confirme son statut d’œuvre pré‑féministe et d’une audace remarquable. selon les circonstances.
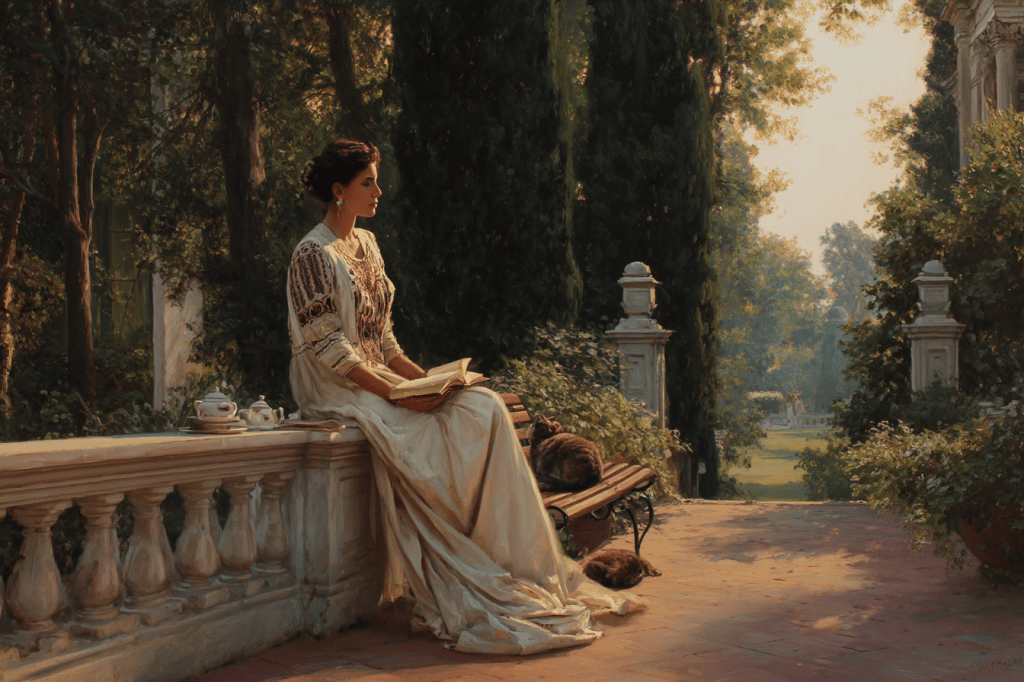






Laisser un commentaire