- Résumé dynamique de la pièce
- Les personnages principaux : un conflit d’idéaux
- Thèmes majeurs
- Style et choix dramaturgiques
- Portée philosophique et politique
- Conclusion
- 📕 Le résumé de la pièce
Jean Anouilh écrit Antigone en 1942, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est occupée par l’Allemagne nazie. La pièce est créée le 4 février 1944 au Théâtre de l’Atelier à Paris, dans une mise en scène d’André Barsacq, en pleine Occupation. Ce contexte historique singulier imprègne profondément l’œuvre et sa réception. Il fallait oser, devant l’Occupant, montrer la révolte exaltée d’une jeune fille contre le pouvoir en place. Anouilh puise dans la tragédie antique de Sophocle un écho aux enjeux de son temps, comme il l’explique plus tard : « L’Antigone de Sophocle […] a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l’ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre ». En effet, l’idée de cette réécriture aurait germé après un fait divers de 1941 : le geste héroïque et isolé du résistant Paul Collette, qui tenta d’assassiner deux dirigeants collaborationnistes, geste « héroïque et vain » qui frappe Anouilh et lui semble contenir « l’essence même du tragique ». Ainsi, la figure de la jeune Antigone défiant l’ordre établi devient pour l’auteur une métaphore puissante de l’individu en résistance face à l’oppression.
Une tragédie antique aux résonances contemporaines : Anouilh transpose le mythe thébain dans un langage moderne et un cadre scénique contemporain, tout en respectant l’unité de lieu et de temps chère au théâtre classique. Barsacq crée des décors et costumes volontairement modernes : Créon apparaît non en toge mais en habit noir de chef d’État moderne (frac), les gardes portent de longs manteaux noirs rappelant l’uniforme de la Gestapo. Le public de 1944 ne s’y trompe pas : malgré l’apparence d’une histoire grecque lointaine, Antigone parle de leur réalité. Présentée dans un Paris occupé, la pièce provoque immédiatement des réactions contrastées. D’un côté, une partie du public et de la critique voit clairement en Antigone le symbole de la Résistance et de la révolte contre un ordre injuste. Simone Fraisse écrit en 1944 que « l’esprit de la Résistance s’est reconnu en elle ». Pour ces spectateurs, il fallait du courage pour braver la censure et célébrer ainsi la liberté de dire non : « Il fallait oser s’inspirer de la Résistance pour donner une écriture nouvelle à l’histoire d’Antigone ». En effet, le manuscrit fut approuvé par les autorités allemandes, qui pensaient sans doute qu’une tragédie antique ne présentait « aucun risque », et l’ont laissé passer sans en percevoir la portée subversive. L’ironie est que cette approbation des censeurs a ultérieurement fait naître un soupçon de compromission autour d’Anouilh.
De l’autre côté, certains reprochent à la pièce une ambiguïté morale. Le régime de Vichy et la presse collaborationniste se félicitent de voir la rébellion écrasée à la fin de la pièce. Un critique d’extrême-droite va jusqu’à louer « Antigone, petite déesse de l’anarchie » dont la « révolte insensée et magnifique » aboutit heureusement, selon lui, au rétablissement de l’ordre par Créon. Pour ces collaborateurs, la pièce justifierait le pouvoir en place : Créon, humanisé, incarnerait Pétain, le vieil homme d’État qui fait des choix difficiles sans s’embarrasser de morale, et Antigone représenterait une jeunesse idéaliste certes pure, mais dont la désobéissance mène au chaos. À l’inverse, dans la presse résistante, on accuse Anouilh de pessimisme complice : le journal Les Lettres françaises dénonce la « trouble connivence » entre Créon et Antigone, deux personnages qui chacun à leur manière « méprisent les hommes », l’un par l’oppression, l’autre par un retrait suicidaire. Le critique Claude Roy, en mars 1944, voit dans cette double négation un désespoir dangereux, qui risque de pousser le public à la résignation en ces « temps de mépris et de désespoir ». Selon lui, « à force de se complaire dans le “désespoir” et le sentiment de […] l’absurdité du monde, on en vient à […] acclamer la première poigne venue » – autrement dit, à accepter le joug du premier tyran venu. Après la Libération, des figures comme André Breton iront jusqu’à traiter Antigone d’« œuvre d’un Waffen-SS », accusant Anouilh d’avoir, par cette tragédie nihiliste, servi la propagande de l’Occupant.
Face à ces attaques, d’autres personnalités prennent la défense de l’auteur. Le général Koenig, héros de la France Libre, s’exclame à la fin d’une représentation : « C’est admirable ! », et le journaliste Pierre Bénard affirme ne pas voir là une œuvre fasciste mais au contraire « un accent antifasciste », refusant de croire « qu’Antigone [soit] une œuvre vouée à la dictature ». De fait, Anouilh lui-même a toujours revendiqué l’esprit de résistance de sa pièce. Dans la préface de 1946, il évoque la rencontre entre Sophocle et « la tragédie que nous étions alors en train de vivre », laissant entendre qu’Antigone est née d’une volonté sincère de dénoncer l’oppression. Le paradoxe est que cette dénonciation s’exprime à travers une tragédie dont l’issue est fatale pour l’héroïne – mais, comme on le verra, la victoire d’Antigone est ailleurs. Quoi qu’il en soit, ce contexte de création donne à la pièce une intensité particulière : Antigone est à la fois une « métaphore de la Résistance face au régime nazi », un drame intimiste sur la conscience individuelle, et « une relecture d’une tragédie grecque » librement adaptée aux enjeux modernes. C’est cette richesse de sens, nourrie par l’Histoire, qui a fait d’Antigone l’œuvre la plus célèbre et la plus jouée d’Anouilh.
Résumé dynamique de la pièce
Antigone se présente comme une tragédie en un acte, dont l’issue funeste est annoncée d’emblée par un Prologue. Dès l’ouverture, le Prologue (personnage-narrateur) brise le suspense : il nous montre les protagonistes sur scène et révèle que l’histoire est déjà écrite. La frêle jeune fille silencieuse, là-bas, c’est Antigone, et « elle sait qu’elle va mourir ». « Elle s’appelle Antigone et il va falloir qu’elle joue son rôle jusqu’au bout… » annonce-t-il solennellement. Le décor est planté à Thèbes, ville légendaire ravagée par un drame familial : les deux fils d’Œdipe, Étéocle et Polynice, se sont entretués dans une lutte fratricide pour le trône. Créon, oncle d’Antigone et nouveau roi, a décidé d’honorer le premier par des funérailles royales et de laisser le corps du second pourrir à ciel ouvert, infâmie réservée aux traîtres. Quiconque osera enterrer Polynice sera puni de mort.
Au lever de rideau, Antigone, plus jeune fille d’Œdipe, a déjà commis l’irréparable : profitant de la nuit, elle s’est glissée hors du palais pour jeter une poignée de terre sur le cadavre de son frère Polynice, accomplissant ainsi les rites funéraires que le roi avait proscrits. Ismène, sa sœur aînée, belle et raisonnable, avait refusé de l’aider par peur de la loi de Créon. Antigone, elle, n’a pas pu supporter l’idée que l’âme de son frère n’ait pas le repos. Au petit matin, un garde la surprend près du corps violant l’édit royal, et la jeune princesse est aussitôt arrêtée. Créon se retrouve donc contraint d’appliquer son propre décret : il a juré de faire exécuter quiconque enterrerait Polynice, même si c’est sa nièce bien-aimée.
La confrontation centrale de la pièce peut alors avoir lieu. Antigone est amenée devant Créon, et on assiste à un long face-à-face tendu, véritable joute verbale où s’opposent deux visions du monde. Créon, d’abord incrédule en découvrant que l’adolescente tranquille a bravé son ordre, cherche à comprendre. Il aime sincèrement cette nièce qu’il a élevée comme sa propre fille et il voudrait la sauver du destin qu’elle s’est forgé. Commence alors un dialogue poignant, presque intime, à l’écart du reste du monde. Créon essaye de raisonner Antigone : pourquoi s’obstine-t-elle à vouloir enterrer ce frère rebelle qui aurait mis Thèbes à feu et à sang ? Polynice, explique-t-il, était un agitateur ambitieux, indigne de son sacrifice. Antigone, inflexible, répond qu’elle devait le faire – pour elle-même, pour le principe, pour l’honneur de son frère et la loi non écrite qui exige qu’on rende dignement les morts. Peu importe que Polynice eût tort ou raison : « Moi je devais le faire, devant tout le monde. Il fallait que je le fasse, sinon je ne pourrais plus me regarder en face », clame-t-elle en substance. Les arguments de Créon glissent sur elle ; il lui offre pourtant une porte de sortie. Dans la version d’Anouilh, le roi va jusqu’à proposer un compromis secret : il est prêt à étouffer l’affaire. Si Antigone accepte de nier son geste, il fera comme si de rien n’était – après tout, seuls les gardes savent qu’elle a essayé d’enterrer Polynice. Créon suggère qu’on peut facilement les faire taire, éviter le scandale, et qu’Antigone pourra alors épouser son fiancé Hémon et vivre heureuse. « Tu as tout la vie devant toi, Antigone », lui souffle-t-il en somme, « Ne la gâche pas pour un entêtement. » Mais Antigone refuse catégoriquement de saisir cette chance. Mentir, vivre dans le déni et la honte ? Très peu pour elle. Sa décision est irrévocable : elle ira jusqu’au bout, jusqu’à la mort s’il le faut, pour que la vérité – sa vérité – triomphe, ne serait-ce qu’un instant.
Face à l’absolutisme d’Antigone, Créon finit par se mettre en colère. L’échange monte en intensité, chacun poussant l’autre dans ses retranchements. Antigone reproche à son oncle d’avoir dit « oui » au pouvoir, d’avoir accepté d’être roi au prix de sa propre intégrité. Créon, blessé, réplique qu’il n’avait pas le choix : « Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes… Je le pouvais [dire non]. Seulement, je me suis senti tout d’un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage… J’ai dit oui », confesse-t-il. « Il fallait dire non, alors ! » lance Antigone dans un cri du cœur. La jeune femme, exaltée, revendique haut et fort sa liberté de refus : « Moi, je n’ai pas dit “oui” ! […] Moi, je peux dire “non” encore à tout ce que je n’aime pas et je suis seul juge », assène-t-elle fièrement à son oncle. Elle lui jette à la face son pouvoir illusoire : avec toute sa couronne, ses gardes et son apparat, Créon ne peut en réalité que la faire mourir parce qu’il a dit oui à l’injustice. Antigone, elle, dans sa faiblesse même, se sent plus forte : « Pauvre Créon… avec mes ongles cassés, mes bras meurtris… moi, je suis reine », déclare-t-elle dans un moment d’intense émotion. Cette ligne, d’une rare puissance tragique, illustre le retournement des valeurs : Antigone, vaincue en apparence, incarne en réalité la souveraineté de la conscience, tandis que Créon, le roi, apparaît démuni face à cette jeune fille qui ne plie pas.
Finalement, Créon, désespérant de la convaincre, n’a d’autre choix que d’ordonner l’exécution. Antigone est condamnée à être murée vivante dans un caveau, châtiment digne d’une tragédie antique. La machine tragique se met alors en branle : Créon a accompli son métier de roi jusqu’au bout, sacrifiant sa nièce pour la raison d’État. Mais le destin va lui présenter la facture. Lorsque le caveau est rouvert (trop tard, bien sûr), les gardes découvrent qu’Antigone s’est pendue avec la corde de sa ceinture – elle n’a même pas laissé à Créon le pouvoir de décider de sa mort. Hémon, fils de Créon et fiancé éploré d’Antigone, s’est fait enfermer auprès d’elle ; fou de douleur, il se jette sur l’épée de son père et meurt à son tour après avoir craché au visage du roi. La tragédie se conclut dans le sang : Eurydice, la femme de Créon et mère d’Hémon, apprenant le suicide de son fils unique, se tranche la gorge à l’intérieur du palais. En l’espace de quelques instants, Créon perd tout : sa nièce rebelle qu’il aimait comme sa propre enfant, son fils adoré, et sa reine. Seul, écrasé, Créon reste en scène, accablé par le poids de ses décisions. Le Prologue/Chœur vient clore la pièce en constatant l’inexorable fatalité qui s’est accomplie. Le rideau tombe sur l’image de Créon, chef victorieux en apparence – l’ordre a été rétabli à Thèbes –, mais vieil homme vidé, dont la victoire politique sonne comme une défaite intime.
Ainsi, Antigone se termine dans un silence glacé. La jeune héroïne est morte, mais son acte de désobéissance aura secoué jusqu’aux fondements du pouvoir. La tragédie, annoncée dès le départ, s’est déroulée inexorablement, laissant le spectateur à la fois terrassé par le destin implacable et admiratif devant la figure d’Antigone, cette héroïne de l’absolu.
Les personnages principaux : un conflit d’idéaux
Antigone
Antigone est le personnage-titre et l’âme de la pièce. Fille d’Œdipe et de Jocaste, sœur cadette d’Ismène et des deux frères ennemis Étéocle et Polynice, c’est une jeune femme de caractère, à la fois fragile d’apparence et inébranlable intérieurement. Anouilh la décrit dès le Prologue comme « la petite maigre […] noiraude et renfermée » que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Elle n’a pas la grâce féminine et la beauté éclatante de sa sœur Ismène – « pas assez coquette » dit-on d’elle –, mais elle possède une force de volonté peu commune. Antigone est l’archétype de l’idéaliste intransigeante. À peine sortie de l’adolescence (elle a environ 20 ans), elle brûle d’un feu intérieur : « Je veux tout, tout de suite – et que ce soit entier… ou alors je refuse ! » pourrait être sa devise. Cette soif d’absolu la pousse à défier l’autorité royale au nom d’un devoir moral supérieur. Elle estime en effet que les lois non écrites (les devoirs envers les morts, la justice divine ou la conscience) priment sur les lois des hommes. En cela, Antigone reprend le flambeau de l’héroïne sophocléenne qui déclarait déjà, chez Sophocle, agir « selon les lois immortelles des dieux » contre l’édit de Créon. Mais chez Anouilh, Antigone semble moins invoquer les dieux que sa conscience intime : elle agit « pour elle-même », parce qu’elle n’aurait pas pu vivre avec l’idée d’avoir laissé son frère sans sépulture. Son courage confine à l’obstination, voire à l’entêtement suicidaire – et la pièce met en scène aussi ses doutes et ses peurs. Car Antigone a peur, elle le dit ; elle est terrorisée à l’idée de mourir, elle avoue à la fois à sa nourrice et à Hémon qu’elle aurait bien voulu vivre, connaître le bonheur simple d’être la femme d’Hémon, avoir un enfant… « Moi aussi j’aurais bien voulu ne pas mourir », confie-t-elle dans un moment d’émotion. Mais, ajoute-t-elle aussitôt, « c’est plus fort qu’elle ». Antigone ne peut pas se dérober à son destin : « Il n’y a rien à faire… il faut qu’elle joue son rôle jusqu’au bout ». Cette dualité rend le personnage extrêmement touchant : Antigone n’est pas une héroïne froide et sûre d’elle, c’est une jeune fille qui aurait aimé vivre, aimer, mais qui se sent appelée par quelque chose de plus grand qu’elle. Son inébranlable “non” est à la fois un cri de révolte et un sacrifice de soi. Jusqu’au bout, Antigone restera fidèle à elle-même, préférant la mort à la compromission : en cela, elle incarne une forme de pureté tragique. Elle apparaît comme la conscience du monde, celle qui refuse de « se taire, mentir ou faire semblant », quitte à en payer le prix. Son nom même, “Antigone”, évoque étymologiquement l’opposition (anti-) à toute naissance ou génération (-gone) : c’est celle qui va à rebours de l’ordre établi. Elle entre en collision avec tout ce qui la dépasse – la loi, l’État, la famille, le destin – portée par un inextinguible besoin de vérité et de justice.
Créon
Face à elle se dresse Créon, le roi de Thèbes, son oncle. Loin d’être un tyran monolithique, le Créon d’Anouilh est un personnage tout en nuances et en désenchantement. Âgé d’environ 50 ans, « réfléchi et courageux », Créon est présenté comme un homme usé par le pouvoir et terriblement seul : « Créon est seul », nous dit-on. Jadis bon vivant, frère de Jocaste et oncle affectueux, il s’est retrouvé propulsé roi malgré lui, après la mort des princes héritiers. Il confie qu’il aurait préféré continuer à vivre paisiblement, loin des responsabilités écrasantes du trône : « Dieu sait si j’aimais autre chose dans la vie qu’être puissant… ». Mais par sens du devoir, il a dit “oui” à la couronne et depuis lors, il s’astreint à assumer les obligations du pouvoir envers et contre tout. Créon se veut le garant de l’ordre, de la stabilité de l’État, quitte à faire des sacrifices personnels immenses. On le voit dans la pièce prêt à sacrifier sa réputation (en couvrant Antigone) par amour pour sa nièce, puis contraint de sacrifier Antigone elle-même pour tenir parole devant le peuple. Cette contradiction le déchire. Anouilh en fait un homme fatigué, lucide et pragmatique, qui porte sur ses épaules le poids du royaume. Créon est conscient de l’horreur de son décret (laisser Polynice sans sépulture le répugne autant qu’Antigone), mais il estime que la raison d’État l’exige : « C’est le métier qui le veut », dit-il avec amertume.
Au cours de la confrontation, Créon montre un visage étonnamment humain : loin d’être un monstre froid, il souffre de la situation. Il supplie presque Antigone de comprendre la nécessité de son acte. Son argumentation est celle d’un homme d’expérience qui a perdu ses illusions. Il tente d’ouvrir les yeux d’Antigone sur la réalité : « La vie n’est pas ce que tu crois, Antigone. C’est une eau qui coule entre les doigts des jeunes gens… Ferme les mains, retiens-la », lui conseille-t-il en substance. Dans un monologue célèbre, il explique que la vraie bravoure n’est pas de mourir pour des idées, mais de vivre quotidiennement malgré les compromis, de porter le fardeau des responsabilités jour après jour. C’est un crédo profondément anti-héroïque que défend Créon : selon lui, le bonheur modeste et l’ordre valent mieux que le malheur grandiose et le chaos. On devine dans ses propos l’écho du contexte de l’époque – un argumentaire qui aurait pu être celui d’un partisan du “moindre mal” sous Vichy, prônant la survie du peuple et l’apaisement plutôt que l’héroïsme suicidaire. Mais Créon n’est pas dépeint comme un traître sans âme : c’est un père et un oncle aimant, qui voudrait éviter le pire aux siens. Sa tragédie personnelle est qu’en endossant le rôle du roi, il s’est piégé lui-même : « Vous avez dit ‘oui’. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant ! » lui lance Antigone. En effet, Créon paiera jusqu’au bout – par la mort de tous ses proches. À la fin, il endosse stoïquement sa solitude de chef. L’image finale de Créon, restant seul pour gouverner un pays pacifié au prix du sang, est poignante : ce « roi-victime » inspire presque la pitié. Le personnage de Créon incarne ainsi la voix de la raison et du compromis, mais aussi l’échec d’une vie passée à trahir ses propres valeurs pour maintenir un ordre absurde. Il suscite chez le spectateur un mélange de rejet (pour sa cruauté envers Antigone) et de compassion (pour le sort épouvantable qui l’attend). Par son humanisation, Créon dépasse la figure du tyran unidimensionnel : il devient le symbole tragique de l’homme de pouvoir déchiré entre le devoir et le cœur.
Ismène
Ismène est le contrepoint d’Antigone, sa sœur aînée au caractère doux et prudent. Belle, féminine, « coquette » et raisonnable, Ismène représente au début de la pièce la voix de la conciliation et de la soumission aux lois. Quand Antigone lui confie son projet d’enterrer Polynice envers et contre l’édit de Créon, Ismène tente de l’en dissuader fermement : « Réfléchis, Antigone, c’est insensé… Nous ne sommes que des femmes, nous ne pouvons pas lutter contre les hommes qui détiennent le pouvoir » – telle est en substance sa réaction. Elle incarne la majorité silencieuse, ceux qui ont peur de mourir et préfèrent ne pas faire de vagues. Ismène aime sa sœur profondément, et c’est par amour pour elle qu’elle refuse de la suivre dans son geste fatal. Elle préférerait voir Antigone vivante et honteuse plutôt que martyre morte. Cette attitude “raisonnable” la fait apparaître d’abord comme un peu lâche aux yeux d’Antigone, qui la repousse durement. Cependant, le personnage d’Ismène gagne en intensité à la fin : lorsque Antigone est arrêtée, Ismène revient vers Créon et tente de partager la faute pour mourir aux côtés de sa sœur (« Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle ! » déclare-t-elle). Antigone, par fierté ou par protection, refuse catégoriquement le sacrifice d’Ismène et la renvoie à la vie. Mais cette volte-face d’Ismène révèle son courage latent et surtout son amour sororal absolu. Ismène, qui voulait vivre, est finalement prête à mourir par loyauté envers sa sœur – trop tard toutefois pour qu’Antigone l’accepte. On découvre alors une Ismène tragique elle aussi, condamnée à survivre après le carnage final. En Ismène se reflètent nombre de spectateurs ordinaires, tiraillés entre l’attrait de l’héroïsme et la peur des conséquences. Sa présence met en relief, par contraste, l’exceptionnalité d’Antigone. Elle apporte également une touche d’émotion : leur relation fraternelle, entre disputes et tendresse, rend d’autant plus déchirant le destin d’Antigone.
Hémon
Hémon est le fils de Créon et fiancé d’Antigone. Jeune homme discret et loyal, il se trouve déchiré entre son devoir filial et son amour pour Antigone. Au début de la pièce, Hémon n’a pas conscience du drame qui se joue. On le voit surtout comme l’amoureux transi de la fougueuse Antigone. D’après le Prologue, tout le destinait à aimer la belle Ismène – ils partageaient les plaisirs simples de la jeunesse –, mais c’est Antigone qu’il a choisie, sans qu’on sache vraiment pourquoi. Il y a sans doute en Hémon une sensibilité qui répond à celle d’Antigone. Lorsque la condamnation tombe, Hémon tente d’intercéder auprès de son père pour sauver sa promise, mais Créon reste inflexible. Anouilh ne développe pas autant le personnage qu’un Sophocle (où Hémon affronte son père dans une scène de dispute plus vigoureuse). Ici, Hémon apparaît surtout dans le dénouement : c’est un amoureux désespéré. En apprenant la mort d’Antigone, il fait le choix tragique de la rejoindre dans la tombe. Son suicide, en se perçant de son épée devant Créon, est un acte d’ultime protestation – un dernier “non” opposé à son père et à l’avenir sans Antigone. Hémon, personnage tendre et effacé durant l’intrigue, prend alors une dimension héroïque posthume. Il personnifie l’innocence sacrifiée sur l’autel du conflit entre Antigone et Créon. Sa mort et celle de sa mère Eurydice constituent le châtiment final de Créon, le faisant passer du statut de roi victorieux à celui de père brisé et d’époux endeuillé. En somme, Hémon incarne l’amour fidèle jusqu’à la mort. Son sort renforce l’idée que personne ne sort vainqueur de cette tragédie : le prix de la raison d’État de Créon est la destruction de sa propre descendance.
Le Chœur / Prologue
Anouilh reprend dans Antigone le dispositif du Chœur de la tragédie grecque, en l’adaptant à sa manière. Ici, le Chœur est en fait un Prologue, un personnage (ou une entité) qui intervient hors de l’histoire pour commenter l’action. Au lever du rideau, c’est le Prologue qui, tel un narrateur omniscient, s’adresse directement au public. Habillé en smoking moderne, il introduit les personnages un à un et annonce l’issue fatale d’entrée de jeu. Il déclare notamment que « tout est joué d’avance », donnant le ton fataliste de la pièce. Cette manière de révéler le dénouement dès le début est une rupture par rapport au suspense traditionnel : Anouilh veut ainsi que l’attention du spectateur se porte non pas sur quoi va arriver, mais sur comment et pourquoi cela arrive. Le Chœur revient ensuite ponctuellement au fil de la pièce, comme une voix de la raison ou du poète, pour guider la réflexion. Il intervient notamment pour annoncer les moments clés (par exemple, il peut commenter après l’arrestation d’Antigone, ou avant le dénouement, afin de souligner le sens de ce qui va se passer). Véritable porte-parole de l’auteur, le Chœur chez Anouilh a un rôle métathéâtral : il souligne que nous sommes en présence d’une représentation, d’une “machine tragique” en marche. Son discours initial présente la tragédie comme « reposante » parce qu’il n’y a plus d’espoir, seulement l’inéluctable. Il dépeint Antigone comme une héroïne qui va au bout d’elle-même, « seule en face de Créon… et qui va mourir ». Cette manière de dédramatiser le drame tout en le rendant inéluctable confère une atmosphère particulière à la pièce, à la fois antique (par la fonction du chœur) et moderne (par le ton presque désabusé et complice envers le public). En exposant d’emblée la fatalité du destin, le Chœur met l’accent sur la dimension philosophique de l’histoire plutôt que sur le mélodrame. Il représente aussi la voix de la sagesse, voire la voix du peuple de Thèbes dans une certaine mesure. À la fin, c’est lui qui prononce les derniers mots, constatant froidement que Créon, désormais seul, doit continuer « son métier ». Il clôt la pièce sur une note de sombre résignation. Ce Chœur-prologue est un héritage direct du théâtre antique que renouvelle Anouilh : il guide les spectateurs dans la lecture morale de la pièce et leur rappelle que ce qu’ils voient est une parabole sur la condition humaine.
Personnages secondaires
Parmi les rôles secondaires, on trouve d’abord la Nourrice d’Antigone et Ismène, familièrement appelée “Nounou”. Cette vieille servante occupe la première scène de la pièce avec Antigone, dans un moment d’intimité domestique. Aimante et terre-à-terre, la Nourrice gronde Antigone rentrée à l’aube, s’inquiète pour elle, parle de petits riens (le chien, le café du matin…). Elle apporte une touche de chaleur et de simplicité dans cet univers tragique. Son échange avec Antigone nous révèle l’attachement profond d’Antigone pour cette figure maternelle de substitution. En même temps, l’incompréhension de la Nourrice face aux tourments d’Antigone souligne l’isolement de celle-ci : Nounou représente le bon sens populaire, incapable de concevoir l’héroïsme tragique. Son personnage, plein de tendresse bourrue, rappelle par instants la nourrice d’Électre ou d’autres tragédies antiques, tout en parlant comme une paysanne ou une grand-mère de la campagne. Elle humanise Antigone en la ramenant à sa condition de jeune fille aimée et couvée, ce qui rend d’autant plus saisissant son choix de tout abandonner pour son idéal.
Les trois Gardes de Créon forment un petit chœur comique et cynique à la fois. Chargés de veiller sur le cadavre de Polynice, ce sont eux qui capturent Antigone. Anouilh en fait des personnages presque grotesques, indifférents aux grands enjeux. Ils jouent aux cartes, se plaignent de leur solde, parlent argot, un peu comme des soldats franchouillards. Leur insouciance triviale apporte des moments de décalage humoristique au cœur de la tragédie. Après l’arrestation d’Antigone, l’un des gardes raconte avec candeur comment ils l’ont prise en flagrant délit, dans une scène qui frôle le vaudeville (il hésite, répète les mêmes mots, s’excuse de déranger le roi avec ça). Créon lui-même souligne que ces hommes « n’ont pas voulu être méchants » : « Ce ne sont pas de mauvais bougres », écrit Anouilh en parlant des gardes, « ils ont des petits ennuis comme tout le monde… Ce sont les auxiliaires toujours innocents ». Cette description, qui rend les sbires du tyran presque sympathiques, a choqué certains résistants en 1944, y voyant une banalisation des exécutants de l’oppression (les gardes en cirés noirs évoquent les miliciens de Vichy). Sur le plan dramatique toutefois, leur présence souligne l’absurdité de la situation : ces gardiens obtus ne comprennent rien à l’acte d’Antigone, ils en sont juste les instruments aveugles. Ils symbolisent la médiocrité du petit fonctionnaire qui “fait son boulot” sans états d’âme. Leur flegme après la mort d’Antigone – ils jouent aux cartes pour tuer le temps près du caveau – accentue par contraste la grandeur tragique de l’héroïne. Anouilh les utilise aussi pour désamorcer l’émotion extrême par instants, fidèle à son style mélangeant tragique et prosaïque.
Enfin, Eurydice, la reine de Thèbes, épouse de Créon, est un personnage à peine visible mais qui revêt une signification symbolique. Anouilh la montre en train de tricoter calmement au palais, comme étrangère à tout ce tumulte politique. Elle tricote pour les pauvres, dit-on, image d’une bonté simple et passive. Elle n’intervient pas dans l’action – « les pauvres auront froid cet hiver », commente le Chœur lorsqu’elle se suicide, car plus personne ne tricotera pour eux. Son suicide, appris via un messager, est l’ultime coup de masse qui s’abat sur Créon. Eurydice représente la victime collatérale, l’innocence silencieuse broyée par la tragédie. Sa mort, en écho à celle de la reine Eurydice dans Sophocle, achève de plonger Créon dans le désespoir total. Notons que la brièveté de son apparition est voulue : Eurydice est quasiment une ombre, dernier sacrifice exigé par le destin pour punir le roi.
Au final, Antigone offre une galerie de personnages opposant deux camps sans manichéisme simpliste : d’un côté les partisans de la vie, du compromis ou de la résignation (Créon, Ismène, la Nourrice, les gardes) et de l’autre les figures de l’absolu, de la révolte et du devoir sacré (Antigone, Hémon dans une certaine mesure). Chacun existe avec ses raisons, ses faiblesses, et c’est la collision de ces univers qui fait jaillir le tragique. Il n’y a pas de “méchant” pur ni de “bon” sans reproche dans cette version de la légende – c’est en cela qu’Anouilh renouvelle profondément le mythe. Comme l’observe un commentateur, « dans cette version de la tragédie, il n’y a pas de vraies frontières entre les bons et les mauvais », et c’est précisément « l’aspect le plus caractéristique et intéressant de l’histoire ». Cette ambiguïté confère aux personnages une résonance universelle : ils incarnent des postures morales dans lesquelles chaque spectateur peut se reconnaître ou se questionner.
Thèmes majeurs
L’autorité : Antigone est avant tout le choc frontal entre l’individu et le pouvoir étatique. Créon incarne l’autorité, la raison d’État, avec toute la solitude et la froideur que cela implique (« Créon est seul »). La pièce explore la nature du pouvoir : est-il par essence corrupteur, obligeant à des actes cruels pour préserver la cité ? Créon représente le pouvoir établi qui se veut pragmatique : interdire la sépulture de Polynice était pour lui un mal nécessaire afin d’asseoir son règne et dissuader les traîtres. Son pouvoir s’exprime par des lois arbitraires et la force (ses gardes armés, la menace de mort) – c’est un pouvoir coercitif. Antigone, en face, détient un pouvoir moral : celui de dire non. Elle oppose à l’autorité de Créon l’autorité de sa conscience. Tout le dialogue entre eux questionne la légitimité du pouvoir : Créon a le pouvoir de tuer, mais Antigone a le pouvoir de refuser d’obéir. Dans cette confrontation, le pouvoir politique est mis en accusation – surtout dans le contexte de 1944. On y lit une critique du despotisme (Créon peut faire exécuter qui il veut), mais aussi une réflexion plus subtile : Créon n’aime pas le pouvoir pour le pouvoir, il le porte comme un fardeau au nom du bien commun. Cela soulève des questions complexes : jusqu’où peut-on aller par devoir de gouverner ? Le pouvoir justifie-t-il tous les sacrifices (même celui de sa famille) ? Anouilh ne donne pas de réponse univoque, mais en humanisant Créon, il montre combien le pouvoir peut isoler et broyer l’homme qui l’exerce. Créon est un chef tragique justement parce qu’il n’est pas entièrement mauvais – son pouvoir l’oblige à renier son humanité. Enfin, la fin de la pièce illustre la vacuité du pouvoir sans amour : Créon reste roi, mais il a tout perdu. Le pouvoir, associé au « oui » (oui à l’ordre, oui à l’ambition), apparaît comme un pacte faustien qui mène à la catastrophe humaine.
Le devoir : La notion de devoir irrigue toute la pièce, mais elle s’incarne différemment chez les personnages. Pour Créon, le devoir du roi prime sur ses affections personnelles. Il dit clairement qu’il “assume les sacrifices nécessaires” de son rôle, y compris punir Polynice et Antigone pour le bien de la cité. Son devoir est lié à sa fonction sociale : c’est le devoir civique, politique, avec sa dureté (on pense au devoir du soldat qui doit parfois exécuter des ordres cruels). À l’opposé, Antigone suit le devoir familial et moral : enterrer son frère selon les lois non écrites de piété filiale. Elle se sent aussi investie d’un devoir envers elle-même : « je suis seule juge » dit-elle de ce qu’elle doit faire ou non. Son devoir est intérieur, absolu, irréductible aux contingences. Ces deux conceptions du devoir s’opposent frontalement. Un point intéressant est que chacun des deux protagonistes reproche à l’autre de trahir son devoir véritable : Antigone accuse Créon de renier la justice et la famille (devoir moral) au profit de sa fonction, tandis que Créon accuse Antigone de manquer à son devoir envers la vie, son devoir de future épouse, etc. Il lui dit en somme : tu aurais dû accepter de vivre, ton devoir n’était pas de mourir inutilement. La pièce met donc en lumière le conflit des devoirs : aucun des deux n’a objectivement tort dans son registre, et c’est cette contradiction insoluble qui crée le drame. D’autres personnages incarnent aussi la loyauté : Ismène pense que leur devoir de sœurs est de ne pas défier la loi (elle est partagée entre le devoir familial et civil, choisissant d’abord la soumission, puis la solidarité lorsqu’il est trop tard). Hémon incarne la loyauté amoureuse absolue, en se donnant la mort pour Antigone. Même les gardes ont une forme de devoir : « C’est le métier qui veut ça », répètent-ils, fatalistes, justifiant ainsi leur obéissance aveugle. Antigone pousse donc la réflexion sur les différents visages du devoir – qu’il soit éthique, familial ou professionnel – et sur les dilemmes qu’il engendre lorsqu’ils entrent en collision.
La loi, la justice et la désobéissance : Au cœur de la pièce se trouve l’opposition entre les lois humaines et les lois supérieures (divines ou morales). Créon a promulgué une loi qu’il doit faire respecter à tout prix – c’est la loi de la cité, positive, mais injuste aux yeux d’Antigone. Celle-ci invoque une justice supérieure, intangible : « les lois non écrites » chères à Sophocle, autrement dit le droit naturel, la voix des dieux ou de la conscience qui dit qu’on ne peut refuser la sépulture à un mort. Anouilh reprend ce conflit immémorial entre le droit légal et le droit légitime. Antigone est sans doute l’une des figures de désobéissance civile les plus célèbres : elle brise la loi pour suivre son idée de la justice. Ce thème résonne fort en 1944 (suivre les lois de Vichy ou les braver au nom de la morale ?), mais il demeure universel. La légalité contre la légitimité, voilà l’enjeu. Dans la pièce, Antigone ne transige pas : « Qu’est-ce que cela me fait, à moi, votre politique, vos nécessités ? » lance-t-elle à Créon. Elle juge la loi de Créon illégitime et l’enfreint. La dignité d’Antigone naît de ce refus obstiné de reconnaître une loi inique. Créon, en retour, considère la désobéissance comme le plus grand des crimes car elle menace l’ordre social. Il représente le positivisme juridique (la loi est la loi, on l’applique) et Antigone le droit de résistance à l’oppression. Le thème de la justice parcourt aussi la pièce via les interrogations : Est-il juste de tuer Antigone pour avoir honoré son frère ? Est-il juste de laisser une sœur pleurer un frère sans pouvoir l’enterrer ? Est-il juste de condamner une innocente pour maintenir la crédibilité de la loi ? Ces questions ne sont jamais posées de façon rhétorique, mais s’incarnent dans le drame. En filigrane, Anouilh montre que la justice humaine est faillible et ambiguë. Créon n’est pas un tyran injuste au sens commun : il a même des raisons valables (Polynice était un traître, punir son cadavre est un exemple pour éviter d’autres guerres civiles). Antigone, elle, est dans son bon droit moral mais en violant la loi elle crée le désordre. Ainsi, la pièce fait ressentir la complexité de la notion de justice. Cependant, la sympathie du spectateur va naturellement à Antigone, car son acte altruiste et sacré parle à la conscience universelle. Antigone célèbre finalement la valeur de la désobéissance lorsque la loi elle-même devient injuste. Ce message avait une portée très concrète sous l’Occupation, et garde son actualité dès qu’il est question de résistance morale face à l’arbitraire.
Le libre arbitre : Antigone est un cri de liberté. La liberté de dire non, d’abord : Antigone revendique jusqu’au bout cette dernière liberté fondamentale de l’individu face au pouvoir totalitaire – le refus intérieur. « Je peux dire non à tout ce que je n’aime pas » affirme-t-elle. Par cette phrase, elle s’érige en personne souveraine, qui ne se laisse dicter sa conduite par aucune autorité extérieure dès lors que cela heurte ses valeurs. C’est l’essence même de la liberté existentielle : pouvoir choisir sa mort plutôt qu’une vie en contradiction avec soi. Hémon, en se suicidant, exerce aussi à sa manière une ultime liberté (refusant de vivre sous l’autorité paternelle sans Antigone). En face, Créon représente plutôt la renonciation à la liberté au nom des contraintes sociales. Il a dit oui, il s’est enchaîné à sa fonction. « Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant ! » lui crie Antigone : ayant renoncé à sa liberté initiale (refuser d’être roi), il est condamné à avancer dans cette voie sans échappatoire. La pièce met donc en contraste la liberté individuelle absolue (Antigone choisissant son destin) et la servitude volontaire (Créon prisonnier de son rôle, Ismène courbant l’échine par peur). Le fait qu’Antigone soit emprisonnée puis tuée pourrait faire croire que sa liberté est annihilée. Mais paradoxalement, elle apparaît plus libre dans son cachot que Créon sur son trône, car sa pensée reste affranchie. Au moment de mourir, Antigone conserve son intégrité d’esprit : c’est là que réside sa victoire. Ainsi, la pièce pose la question : Qu’est-ce que la vraie liberté ? Vivre aux dépens de son âme ou mourir fidèle à soi ? Pour Antigone, la réponse est tranchée. Ce choix extrême est mis en scène de façon à la fois admirable et troublante. On peut aussi voir dans Antigone une interrogation sur le libre arbitre face au destin (voir le thème du destin ci-dessous). Antigone dit à plusieurs reprises qu’elle « n’a pas le choix », que c’est plus fort qu’elle, comme si sa liberté même était de se soumettre à son destin tragique. Il y a là un paradoxe intéressant : Antigone célèbre la liberté intérieure, mais montre aussi les personnages comme prisonniers de leurs rôles. Anouilh semble suggérer que la véritable liberté est dans la fidélité à sa nature profonde (Antigone naît pour dire non), même si cela ressemble à une fatalité. En définitive, la pièce fait ressentir intensément l’aspiration à la liberté, face à toutes les forces (loi, pouvoir, destin) qui cherchent à la contraindre.
La révolte et le refus : La thématique de la révolte est évidente – Antigone est le portrait d’une insurgée. Anouilh met en scène une révolte sans espoir de victoire concrète, une révolte pour elle-même. Antigone ne prétend pas renverser Créon ni sauver Thèbes, sa révolte est intime et existentielle. C’est le « non » de l’individu qui dit : je ne participerai pas à cette injustice, quitte à en mourir. Cette révolte prend chez Antigone une forme absolue : elle ne transige sur rien, ne calcule rien. Elle a quelque chose en elle de terriblement pur et dangereux, pour paraphraser un critique. Sa révolte, admirable par son courage, est présentée aussi comme insensée et magnifique. Anouilh montre bien que c’est une révolte inutile du point de vue pragmatique – Antigone n’améliore pas le sort de Thèbes, au contraire, son geste cause une chaîne de morts. Mais c’est précisément cette gratuité qui la rend belle. On pense à la fameuse tirade de Cyrano de Bergerac : « On ne se bat pas dans l’espoir du succès ! Non, non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! ». Antigone semble incarner cette idée : elle se bat sans espoir, parce que se battre est la seule chose qui ait du sens pour elle. Sa révolte est à la fois politique (contre un État oppressif) et métaphysique (contre l’absurdité de la condition humaine). Elle a été comparée aux figures de l’absurde chez Camus, qui se révoltent contre un monde dénué de justice. D’ailleurs, certains critiques y voyaient une tentation nihiliste : Antigone refuse le monde tel qu’il est (avec ses compromis, ses mensonges), et préfère le néant (la mort) à l’imperfection. La pièce interroge donc la valeur de la révolte : est-elle un acte de vie ou de mort ? Hémon qualifie Antigone d’« orgueilleuse » qui « voulait tout, tout de suite » ; Créon lui dit qu’elle cherche « à être morte » plus qu’à défendre son frère. Mais d’un autre côté, c’est grâce à des révoltes comme la sienne que le monde peut retrouver un sens de la justice. Sous l’Occupation, Antigone était un modèle pour la jeunesse : « enterrant son frère au prix de sa propre vie, elle représente l’équité, la probité et la révolte contre un État oppressif ». Cette lecture en faisait une allégorie de tous ceux qui disent non à l’oppression. On peut également analyser la révolte d’Antigone comme un refus de la compromission et la corruption. Elle refuse de « vivre sale ». Sa soif de pureté nourrit sa révolte. Ce thème de la pureté vs la compromission est récurrent dans la pièce, notamment lorsque Créon tente de la salir en lui révélant la face obscure de Polynice ou en lui proposant de sortir de l’affaire en douce. Antigone se bouche les oreilles, au sens figuré : rien ne doit venir entacher la noblesse de son acte, pas même la réalité. Sa révolte a quelque chose d’absolu parce qu’elle refuse même les arguments rationnels qui pourraient l’atténuer. C’est en cela qu’elle est tragique et sans retour. Antigone célèbre donc la révolte comme un absolu, tout en montrant son coût exorbitant. Le public est invité à admirer cette révolte libératrice – qui prouve que l’esprit humain ne peut être complètement asservi – mais aussi à en pleurer l’issue fatale.
La fatalité : En fidèle héritier de Sophocle, Anouilh place le destin au centre de la mécanique tragique. Pourtant, son approche du destin est plus humaine que mythologique. Dans la pièce antique, le destin d’Antigone était scellé par les dieux et la malédiction familiale (la lignée d’Œdipe). Dans la version de 1944, le mot “destin” pourrait être remplacé par la nature profonde ou le rôle de chacun. Le Prologue annonce qu’Antigone « va jouer son rôle jusqu’au bout » : il y a l’idée d’une distribution des rôles par avance. Antigone elle-même dit à Ismène : « À chacun son rôle. Lui [Créon] doit nous faire mourir, et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C’est comme cela que ç’a été distribué… ». Cette réplique est clé : elle montre qu’Antigone se voit elle-même comme prise dans un engrenage qui la dépasse (« c’est comme cela que ça a été distribué »). On retrouve là l’ombre de la fatalité antique, mais formulée en termes quasi ludiques (une distribution de cartes, un rôle dans une pièce de théâtre). Anouilh insiste donc sur la dimension théâtrale du destin : les personnages sont conscients qu’ils jouent une tragédie, ils sont lucides sur l’issue, et pourtant ils ne peuvent y échapper. Cela confère à la pièce un parfum d’inéluctable très fort. Le spectateur, qui sait la fin dès le début, ressent d’autant plus l’impression d’assister à une marche du destin. Cette fatalité est soulignée par le Chœur : « C’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir », dit-il en substance. Le destin, ici, peut être compris de plusieurs façons. On peut y voir la fatalité familiale – la “malédiction des Labdacides” qui veut que chaque génération paye les fautes de la précédente. Antigone est bien la fille d’Œdipe, maudite dès sa naissance par les dieux. La pièce rappelle en toile de fond ce contexte mythique. Mais Anouilh se détache de l’explication religieuse : il n’inclut ni dieux ni prophète (Tiresias n’apparaît pas dans cette version). La fatalité prend une forme humaine : ce sont les caractères et les choix passés qui tracent la route. Créon est prisonnier du oui qu’il a dit un jour, Antigone prisonnière de son non. Ainsi, on peut dire que le destin selon Anouilh est en partie auto-construit : Antigone a choisi son destin en enfreignant la loi, Créon a choisi le sien en acceptant le pouvoir. Ensuite, une fois ces choix faits, la logique tragique se referme sur eux comme un piège. Il y a là une vision assez existentialiste du destin : “Destin, c’est le caractère” disait Napoléon. Chez Anouilh on retrouve l’idée que « l’on est acculé à être soi-même ». Antigone ne peut pas échapper à Antigone, Créon ne peut pas échapper à Créon. En ce sens, le destin dans la pièce c’est l’identité profonde de chaque personnage poussée jusqu’à ses ultimes conséquences. La pièce joue constamment sur ce double registre : les personnages parlent du destin comme si c’était une force extérieure (“il fallait que ça arrive”), alors même que ce sont leurs actions volontaires qui le provoquent. Cette ambiguïté donne toute sa profondeur tragique à l’histoire : on assiste à la collision de trajectoires inévitables. Enfin, le destin est mis en scène par la structure cyclique : à la fin, après le bain de sang, le Chœur laisse entendre que la vie normale va reprendre à Thèbes, qu’un autre cycle commencera. Créon continue de régner, les gardes continuent leur service… La fatalité tragique a fait son œuvre puis le monde poursuit sa route indifférent. Cela renforce le sentiment d’un destin absurde et indifférent, thème cher au théâtre du XXe siècle.
L’absurdité de la vie : Au-delà des enjeux politiques, Antigone touche à des questions existentielles universelles. La pièce oppose constamment la jeunesse idéaliste (Antigone, Hémon) et l’âge mûr résigné (Créon, la Nourrice). C’est le heurt de deux visions de la vie : Antigone attend de la vie qu’elle ait un sens, une valeur, quitte à ce que ce sens soit dans une belle mort. Créon, lui, considère que la vie n’a pas de sens transcendant, qu’elle est faite de compromis, de petites joies et de peines, et que vouloir la grandiose est une folie. Quand il dit à Antigone « La vie n’est pas ce que tu crois… », il exprime un point de vue désenchanté, presque cynique, qui rejoint l’absurde camusien : la vie est dépourvue de logique morale (le juste peut mourir et le coupable vivre heureux), il faut faire avec. Antigone refuse cette absurdité : en cela elle rejoint le héros absurde de Camus qui, face à l’absence de sens, décide de se révolter et de donner lui-même du sens par son action. Sa mort devient son acte de sens. On retrouve aussi chez elle une thématique très existentialiste : celle de l’authenticité et de la liberté individuelle. Sartre aurait pu saluer en Antigone un exemple de mauvaise foi refusée : elle ne joue pas le rôle qu’on attend d’elle (la gentille princesse soumise), elle devient elle-même en posant un acte libre. On pense à la phrase de Sartre « l’important n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu’on a fait de moi » – Antigone, héritière d’une lignée maudite, fait quelque chose de ce destin en le transformant en choix. La condition humaine est aussi abordée par la confrontation de l’idéal et du réel. Créon dit en somme à Antigone : « Les humains ne peuvent pas atteindre la pureté que tu réclames. Être humain, c’est accepter d’être imparfait, de faire des erreurs, de faire des concessions ». Antigone répond : « Être humain, c’est dire non à ce qui est indigne, c’est refuser la corruption du cœur ». Ces deux visions se télescopent. Anouilh ne tranche pas explicitement, mais la fin semble donner raison à Antigone sur le plan moral (elle conserve son intégrité, Créon la perd). Toutefois, la fin montre aussi un univers terriblement absurde et vide de sens : tant de morts “pour rien”. Antigone elle-même, dans ses dernières répliques, n’est pas triomphante ; elle a peur, elle souffre, et sa victoire est très intérieure. Créon est vivant et devra assumer l’absurdité de son triomphe amer. Il y a quelque chose de l’ordre du constat Camusien : « Il n’y a pas de paradis pour le juste sur cette terre ». Antigone peut ainsi se lire comme une réflexion sur « que faire de sa vie dans un monde absurde ? ». Deux réponses s’opposent : l’une est de trouver un sens personnel quitte à en mourir (Antigone), l’autre est de vivoter en fermant les yeux sur l’absurde (Créon qui va “continuer à faire son métier”, les gardes qui jouent aux cartes, etc.). La pièce ne fournit pas de morale simple, mais pose un regard à la fois lucide et compatissant sur la condition humaine. Elle rejoint sur ce point les préoccupations du théâtre existentialiste de la même époque (Sartre, Camus) tout en s’en distinguant par son refus d’énoncer clairement une philosophie – Anouilh montre l’absurde plus qu’il ne le commente. Au final, ce qui demeure, c’est l’émotion profondément humaine qui se dégage : la solitude de chacun face à ses choix, face à la mort, face au sens (ou non-sens) de l’existence.
Style et choix dramaturgiques
Lors de sa création, Antigone a été saluée comme une réécriture magistrale de la tragédie antique dans une forme résolument moderne. Le style d’Anouilh y est à son zénith, alliant le respect de la structure tragique classique à des innovations audacieuses de mise en scène et de ton. La pièce obéit aux unités de temps, de lieu et d’action héritées du classicisme français : l’action se déroule en une seule journée, dans l’enceinte du palais de Thèbes, suivant une intrigue linéaire centrée sur le conflit Antigone/Créon. Cette rigueur architecturale donne à la pièce une tension continue rappelant Racine ou Corneille. Pourtant, Anouilh ne se contente pas d’imiter le classicisme : il le dynamite de l’intérieur par des procédés modernes.
D’abord, la présence du Prologue/Chœur qui brise la chronologie et la frontière scène/salle en s’adressant directement au public est une touche brechtienne avant l’heure. En annonçant la fin tragique dès le début, Anouilh prend à contre-pied l’attente dramatique : il crée une sorte de suspense inversé, où l’on guette non pas ce qui va se passer (puisqu’on le sait), mais comment chaque personnage va se comporter face à son destin. Cette technique intensifie la dimension psychologique et philosophique de l’œuvre. Elle procure aussi une expérience particulière au spectateur : une lucidité impuissante, semblable à celle des personnages qui sentent arriver la catastrophe sans pouvoir l’éviter. Ce procédé renforce l’identification aux figures tragiques et la portée du message.
Le langage chez Anouilh est un autre élément notable. Il choisit d’écrire en prose moderne, épurée, mélangeant registre soutenu et langue parlée. Les échanges entre Antigone et Créon sont d’une beauté sobre, presque didactiques parfois (Créon développe de longs arguments rationnels, Antigone répond par des phrases courtes, émotionnelles). À côté de cela, les gardes s’expriment dans un argot trivial, la nourrice a un parler familier. Cette coexistence de niveaux de langue crée un style vivant, fluide et humanisé, qui rend la tragédie accessible et proche du public de l’époque. Un critique de 1944 notait d’ailleurs que depuis Racine on n’avait rien écrit d’aussi « beau […] et d’aussi profondément humain ». Anouilh réussit à faire parler les héros mythiques comme des personnes réelles sans déflorer leur grandeur. Il y a parfois des pointes de poésie (lorsqu’Antigone évoque son bonheur imaginaire avec Hémon, ou quand le Chœur décrit la nuit d’Antigone), mais jamais de grands effets lyriques classico-romantiques : le style reste sobre, elliptique, percutant. Cette maîtrise du langage contribue à créer une émotion intense tout en évitant le pathos grandiloquent.
Le ton de la pièce oscille d’ailleurs entre le tragique pur et une certaine distance ironique. Anouilh insère de l’humour noir et du prosaïsme dans la tragédie : par exemple les gardes discutant de trivialités au moment le plus dramatique, ou Créon ayant des réactions très terre-à-terre face à l’emportement d’Antigone (il lui offre un siège, lui dit « tu es toute pâle »…). Ces touches réalistes, presque comiques, font penser au procédé de Cocteau ou Giraudoux qui mélangeaient déjà les registres dans leurs réécritures mythologiques. Anouilh était de leur génération et s’en réclame : « Giraudoux et Cocteau ont rajeuni, renouvelé des thèmes éternels. Anouilh, tout en suivant de très près le théâtre antique, l’a complètement transformé ; il lui a insufflé un autre esprit », écrivait un critique en 1944. Cet « autre esprit » est en partie cet alliage de profondeur tragique et de légèreté moderne.
Un autre choix marquant est l’anachronisme assumé de la mise en scène : on l’a vu, costumes contemporains, références indirectes à la Gestapo, etc. La temporalité est floue (les personnages parlent parfois comme dans les années 1940 – évoquant des cigarettes, des jeux de cartes – tout en évoluant dans un palais antique). Ce mélange délibéré crée une intemporalité : Antigone n’est plus seulement une histoire de la mythologie grecque, c’est une histoire de toujours et d’aujourd’hui. Cette liberté vis-à-vis de la reconstitution historique tranche avec le théâtre “à costume” traditionnel. Anouilh veut qu’on voie l’analogie avec notre époque, que le spectateur se sente concerné hic et nunc. La sobriété du décor (un décor neutre, esquissé) et l’absence d’entracte renforcent cette immersion.
Sur le plan de la structure dramatique, Antigone est construite comme une tragédie classique en cinq temps : exposition (Prologue + scènes avec la Nourrice et Ismène, qui exposent la décision d’Antigone), montée de la tension (arrestation et confrontation avec Créon), climax (le refus d’Antigone devant l’offre de vie de Créon), catastrophe (condamnation et suicides), dénouement (intervention finale du Chœur). Tout est concentré, tendu vers l’irrévocable. Anouilh, en un acte unique d’une centaine de pages, parvient à une intensité croissante qui culmine lors de la grande scène Antigone/Créon – véritable pivot de la pièce autour duquel tout s’organise. Cette scène est souvent considérée comme un morceau d’anthologie du théâtre du XXe siècle par sa progression dramatique et la force des idées échangées.
Enfin, il faut souligner qu’Anouilh qualifiait Antigone de “pièce noire”. Il classait en effet ses œuvres par couleurs : les pièces “roses” (comédies légères), les “noires” (tragédies du destin), etc. Antigone inaugure selon lui le cycle noir, marqué par un pessimisme intense et l’absence d’issue heureuse. Il disait lui-même qu’après la création de Voyageur sans bagage (1937) et d’Antigone (1944) – deux pièces sombres –, il fut perçu comme un “auteur à idées” au même titre que Sartre ou Camus, bien qu’il s’en défendît. La noirceur d’Antigone tient à l’austérité de sa conclusion (pas de réconciliation ni de catharsis apaisante, juste la désolation) et à la vision du monde qu’elle charrie (un monde d’hypocrisie, d’égoïsme et d’orgueil, dit Anouilh). Pourtant, cette noirceur n’exclut pas l’émotion ni même une certaine exaltation. La langue reste belle et limpide, les personnages sont profondément humains, ce qui fait que la pièce ne laisse pas un sentiment de vide, mais au contraire un mélange d’admiration et de compassion. Comme l’a écrit Olivier Quenant dans L’Illustration en 1944, « depuis Racine, on n’avait rien écrit d’aussi beau, d’aussi grand et d’aussi profondément humain ». Cette appréciation souligne la réussite d’Anouilh : avoir créé une tragédie moderne capable de toucher le public autant par sa grandeur esthétique que par son humanité accessible.
En somme, le style d’Anouilh dans Antigone se caractérise par une économie de moyens (un acte, peu de personnages), une langue claire et ciselée, un rythme soutenu sans digression, et une subtile alternance de registres tragique et familier. C’est une œuvre charnière qui montre qu’on pouvait, au milieu du XXe siècle, écrire une tragédie comme autrefois tout en y insufflant l’esprit de son temps. Anouilh rend ainsi un double hommage : à Sophocle dont il s’inspire fidèlement pour de nombreuses scènes, et au théâtre contemporain en démontrant la viabilité du tragique sur une scène moderne. Cette fusion du classique et du moderne est probablement une clé de la portée universelle de la pièce.
Portée philosophique et politique
L’impact d’Antigone dépasse le cadre théâtral pour toucher aux enjeux philosophiques et politiques de son époque – et des suivantes. Créée en pleine guerre, la pièce a d’abord été lue comme une allégorie de l’Occupation. Cette grille de lecture, nous l’avons vu, opposait un Créon figure du maréchal Pétain (ou de tout pouvoir collaborateur) à une Antigone figure de la Résistance. Effectivement, de nombreux éléments viennent étayer cette interprétation : la jeunesse indomptable d’Antigone face au vieil homme épuisé qu’est Créon évoque la jeunesse résistante contre les “vieilles gloires” compromises du régime de Vichy. Antigone parle au nom de la morale et de l’honneur, là où Créon invoque la raison d’État et l’intérêt politique – on peut y voir le dialogue de sourds entre résistants idéalistes et vichystes pragmatiques. Même des détails scéniques (les gardes à l’allure de miliciens, les costumes modernes) ancrent la pièce dans le présent de 1944. Il n’est pas étonnant que beaucoup de spectateurs de l’époque aient immédiatement identifié Antigone à la France qui dit “non” (on a souvent fait le rapprochement avec le fameux “Non” du 18 juin 1940 de De Gaulle). D’ailleurs, les comédiens eux-mêmes et le public grelottaient de froid dans le théâtre non chauffé, partageant concrètement les privations de la guerre. La résonance patriotique était forte : « jamais, au grand jamais, l’Occupant ne pourrait prendre aux Français leur liberté d’opinion », écrit un commentateur à propos de la pièce, saluant la façon dont elle redonne espoir au peuple asservi. La censure allemande, distraite ou naïve, s’est fait piéger : la propagande collaborationniste voyait au départ dans la fin de la pièce (révolte matée) un message pro-ordre, mais beaucoup de Français y lisaient entre les lignes une exaltation du sacrifice héroïque et un appel à ne pas transiger avec l’ennemi. Dans ce sens, Antigone a pu encourager un esprit de résistance passive : le fait que l’héroïne perde la vie n’en fait pas une vaincue, au contraire. Son “échec” apparent renforce l’idée que la victoire morale appartient à ceux qui refusent de servir l’injustice. C’est un message qui a rallié de nombreux jeunes à l’époque, comme en témoigne la popularité de la pièce et les commentaires enflammés de certains résistants disant qu’ils « se reconnaissaient en elle ».
Cependant, la portée politique d’Antigone est ambivalente, ce qui explique qu’elle a été récupérée un temps par des camps opposés. Cette ambivalence n’est pas forcément une maladresse d’Anouilh, mais plutôt le reflet de sa volonté de peindre la complexité plutôt que de faire une pièce de propagande univoque. Anouilh n’était ni un résistant militant comme Sartre, ni un auteur officiellement collabo ; il était plutôt un homme qui aimait l’ordre autant que la liberté, allergique aux extrémismes. Ainsi, Antigone peut aussi se lire comme une tragédie de l’intransigeance : un avertissement sur ce qui arrive quand deux absolutismes s’affrontent (la pureté idéaliste vs le réalisme autoritaire). C’est ce qu’avait perçu la presse résistante en la critiquant : pour Claude Roy, Antigone et Créon se valent dans leur mépris commun des hommes, l’une se tuant par orgueil, l’autre réprimant par cynisme. Cette lecture y voit une pièce désespérée, où tout le monde a tort parce que personne n’aime réellement l’humanité. Il est vrai qu’Antigone, dans sa quête d’absolu, dit des phrases dures sur la vie qu’elle méprise, sur le bonheur qu’elle refuse comme « sale ». Créon de son côté dit clairement qu’il trouve les gens médiocres et qu’il faut les gouverner sans illusions. Cette vision sombre a pu faire croire que la pièce faisait le jeu du pessimisme ambiant, décourageant la lutte collective. André Breton y a vu une œuvre “ignoble” en ce sens. Mais d’autres, au contraire, y ont vu un hymne à l’espoir paradoxal : Antigone meurt, certes, mais son non finit par triompher symboliquement. D’ailleurs « les résistants libérèrent la France moins d’un an après la première » d’Antigone, comme une confirmation que la jeunesse idéale finit par l’emporter sur les vieux tyrans. On pourrait dire que la pièce, intentionnellement ou non, laissait chaque camp y puiser sa morale – c’est la marque des œuvres riches que de permettre des interprétations multiples.
Au-delà de la conjoncture de 1944, Antigone soulève des questions philosophiques intemporelles. La plus saillante est sans doute celle de l’existentialisme et de l’absurde. Anouilh, sans être philosophe de profession, propose à travers ses personnages un véritable débat existentiel avant l’heure. Antigone peut être vue comme une “héroïne existentielle”, au sens où sa démarche rappelle la formule de Sartre « l’existence précède l’essence ». Elle agit, et par son action elle définit qui elle est. Elle n’est pas prédéterminée à être une rebelle : elle choisit de l’être, elle forge son identité par son acte libre. En cela, elle rejoint les figures sartriennes de la révolte (comme le personnage d’Œdipe chez Sartre dans Les Mouches, autre réécriture tragique de 1943, qui disait non à Zeus). D’ailleurs, la réception d’Antigone à l’époque a souvent comparé Anouilh à Sartre. Certains ont voulu opposer Antigone de Anouilh à Les Mouches de Sartre en disant que la première était une contre-proposition réactionnaire à la seconde, plus engagée à gauche. C’est sans doute excessif, mais cela montre que la pièce d’Anouilh se situe dans le même champ de réflexion sur la liberté, le choix et le sens de l’action. On retrouve aussi des thématiques chères à Camus : Antigone a quelque chose de “l’homme révolté” (titre de l’essai de Camus en 1951). Camus définira la révolte comme ce qui « donne sa valeur à la vie » dans un monde absurde. Antigone illustre parfaitement cette idée : face à l’absurdité (enterrer son frère mène à la mort, ne pas l’enterrer est moralement impossible pour elle), elle se révolte et c’est cette révolte qui lui donne sa dignité d’être humain. Camus aurait pu voir en elle une sœur de son Sisyphe – sinon que Camus préfère la révolte qui vit alors qu’Antigone choisit la révolte qui meurt.
La pièce développe par ailleurs une philosophie de l’absurde très prégnante dans les dialogues. Créon a des accents camusiens lorsqu’il constate l’inanité des ambitions et l’obligation de faire avec un monde imparfait. Antigone, elle, représente la réponse de l’absurde par la révolte suicidaire : elle oppose un acte porteur de sens (enterrer son frère) à un univers qui n’en a pas (puisque cette action ne changera rien objectivement). On peut la voir comme une figure de l’absurde glorifié : elle sait que sa lutte est vaine (« je le sais ! » dit Rostand par la bouche de Cyrano et Antigone pourrait le reprendre), mais elle trouve que « c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ». Là réside une valeur existentialiste forte : la valeur de l’action ne réside pas dans son résultat, mais dans sa sincérité et son intensité. Antigone affirme que « seul compte son accord avec elle-même ». Cette phrase est proche de la notion d’authenticité de Heidegger ou Sartre. Elle place la fidélité à soi au-dessus de toute autre considération.
L’autre question philosophique soulevée est celle de la responsabilité et de la morale individuelle. Anouilh pose la question : vaut-il mieux préserver sa vie au prix d’un reniement (Ismène au début, Créon qui a dit oui) ou préserver sa morale au prix de la vie (Antigone) ? C’est un dilemme moral extrême, mais qui renvoie à des choix plus communs (dans la guerre : collaborer pour survivre ou résister et risquer la mort ?). Antigone a fait réfléchir toute une génération de lycéens et d’étudiants (et continue de le faire) sur cette notion d’intégrité morale. Beaucoup y ont vu un message humaniste puissant : la dignité de la personne humaine réside dans sa capacité à dire non à l’inacceptable. Même si ce “non” paraît absurde ou vain, il est le dernier rempart de l’humanité. C’est ce que souligne la conclusion du blog Nom d’une plume : « Antigone s’est peut-être suicidée, mais elle ressort gagnante du combat, mourant pure, digne, intègre… heureuse même, parce qu’étant restée libre, en accord avec sa conscience ». Créon, lui, « reste seul […] menant une existence à laquelle on pourrait préférer la mort ». Ce renversement final montre la position du dramaturge : la vraie victoire n’est pas celle du vivant au pouvoir, mais celle de la morte intègre. On peut y lire un écho à une certaine pensée chrétienne (mieux vaut perdre le monde que perdre son âme), bien qu’Anouilh ne soit pas croyant. Mais c’est surtout une idée existentialiste : la valeur d’une vie se mesure à la fidélité à ses valeurs, pas à sa durée ou sa réussite matérielle.
Enfin, la postérité philosophique d’Antigone se manifeste dans son universalité allégorique. Après 1944, le mythe d’Antigone revisité par Anouilh a servi de miroir à d’autres contextes d’oppression. Par exemple, l’écrivain Sorj Chalandon raconte dans Le Quatrième Mur (2013) la tentative de monter Antigone pendant la guerre du Liban à Beyrouth, preuve que la pièce parle à toutes les époques où règnent la violence et le dilemme de l’engagement. Antigone est devenue un symbole de la résistance morale universelle : contre les dictatures, contre l’arbitraire, voire dans des contextes familiaux ou personnels (chaque fois qu’un individu dit non à une pression injuste). Le fait qu’Anouilh ait maintenu une ambiguïté (aucun personnage n’est totalement pur ou abject) renforce la richesse de la réflexion. Antigone n’est pas un manifeste simpliste, c’est une œuvre qui invite à la discussion et à l’introspection. Elle fait éprouver au spectateur la beauté du sacrifice autant que sa terrible absurdité, la nécessité de l’ordre autant que son inhumanité, la fougue de la jeunesse autant que la sagesse résignée de l’âge. C’est pourquoi elle continue de « parler aux spectateurs non encore nés au moment de sa création », leur présentant toujours avec éloquence « la jeunesse et l’âge, l’idéalisme et le compromis ».
Conclusion
En définitive, Antigone de Jean Anouilh s’impose comme une tragédie moderne profonde, claire et intensément humaine. Écrite dans les heures sombres de l’Occupation, elle puise à la fois dans le mythe antique et dans la réalité historique immédiate pour poser des questions universelles. Anouilh réussit le pari de renouveler un mythe vieux de 2400 ans en lui insufflant une actualité brûlante, sans pour autant le réduire à un simple pamphlet manichéen. La pièce offre plusieurs niveaux de lecture : allégorie politique d’une époque troublée, drame intime d’une famille royale en décomposition, duel philosophique sur le sens de la vie et la mort.
Le style fluide et maîtrisé de l’auteur, mêlant gravité et familiarité, permet à des lecteurs ou spectateurs jeunes d’aujourd’hui – lycéens de Terminale ou étudiants en début de parcours – de s’approprier facilement cette œuvre. Le ton n’a rien de poussiéreux ni de pontifiant : il y a du naturel dans les dialogues, de l’humour discret, de l’émotion brute. C’est pourquoi Antigone captive toujours : la pièce nous parle à nous, de nos choix, de nos révoltes, de nos renoncements. Les personnages d’Anouilh ne sont pas des figures figées : ce sont des êtres qui doutent, souffrent, aiment. On comprend Ismène autant qu’Antigone, on comprend Créon autant qu’on le condamne. Cette complexité donne à l’ensemble une profondeur humaine remarquable.
En ancrant un conflit antique dans la réalité de 1944, Anouilh a démontré la puissance intemporelle de la tragédie. Son Antigone est à la fois une fille d’Œdipe et une résistante de la Seconde Guerre mondiale, une héroïne mythique et une jeune femme de tous les jours. Elle incarne l’éternel combat de l’individu pour rester fidèle à sa conscience. À la fin de la pièce, le spectateur ressent à la fois de la tristesse et de l’admiration, du questionnement et de la catharsis. Il n’y a pas de “morale” assénée, mais un appel implicite à réfléchir : et moi, qu’aurais-je fait ? Que ferais-je, aujourd’hui, face à l’injustice ? Cette invitation au questionnement fait d’Antigone une œuvre vivante, toujours en mouvement dans nos esprits.
Créon dit à Antigone : « La vie n’est peut-être pas ce que tu crois ». Peut-être. Mais Antigone, en donnant sa vie, a exprimé ce qu’elle croyait que la vie devrait être. Et c’est en cela que cette tragédie nous touche au plus profond : elle confronte nos peurs et nos espoirs, notre désir de bonheur tranquille et notre aspiration à l’idéal. Plus de soixante-dix ans après sa création, Antigone reste ainsi « d’une actualité foudroyante ». On la rejoue partout dans le monde pour interroger de nouveaux contextes oppressifs ou de nouveaux dilemmes moraux, preuve que son message est universel. Comme l’écrivait un critique à la création, « tout en suivant de près Sophocle, Anouilh l’a complètement transformé » – il a fait d’Antigone la tragédie de la condition humaine moderne. Une tragédie où, paradoxalement, dans l’obscurité du désespoir brille encore la lumière indomptable de la conscience.
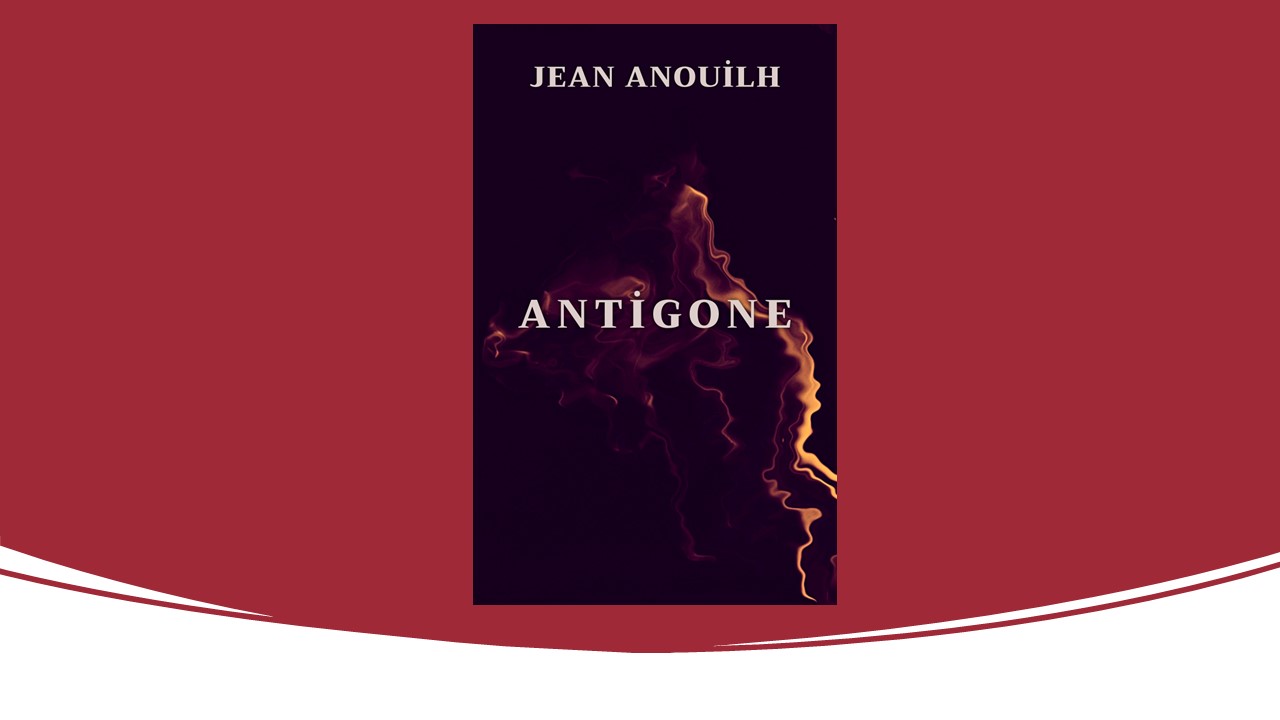






Laisser un commentaire